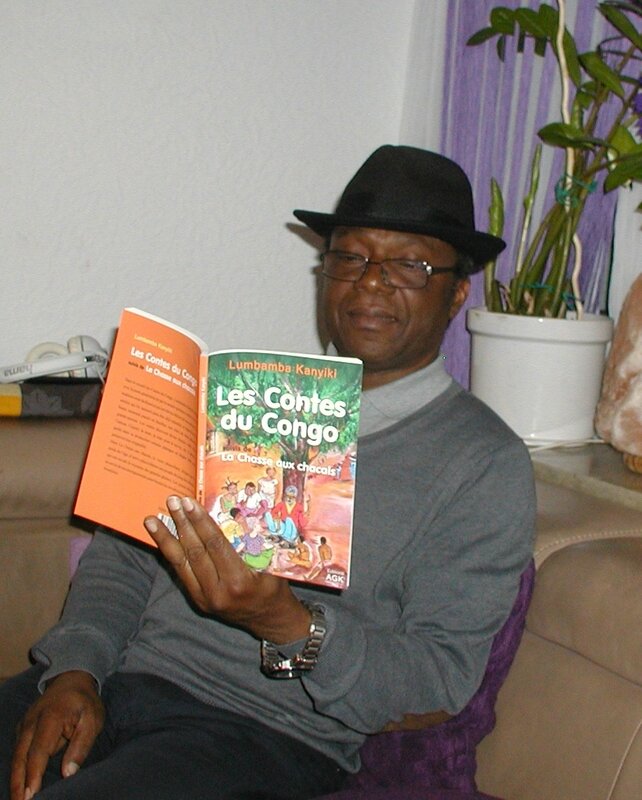Torture: "Casser la logique de l’impunité"
(La Libre 25/06/2011)
L’Onu a consacré le 26 juin Journée mondiale de soutien aux victimes de torture. Avocats sans frontières les aide dans plusieurs pays, tente de consacrer un droit aux victimes d’être reconnues comme telles et d’obtenir réparation.
Entretien
Cela fait bientôt 20 ans qu’Avocats sans frontières, une ONG internationale créée en Belgique, œuvre en faveur d’un accès à la justice pour les plus vulnérables(*). Elle travaille entre autres à la reconnaissance de la torture comme crime spécifique d’une particulière gravité. Parce qu’il est notamment exercé "au nom de l’Etat" et devient "un crime d’Etat", explique Jean-Charles Paras, avocat français, en charge de la coordination des dossiers thématiques à ASF. "Sa prohibition ne souffre aucune exception en droit international", rappelle-t-il, à la veille de la Journée mondiale de soutien aux victimes de torture ce 26 juin.
Bien que l’interdiction de la torture soit indérogeable et absolue en droit international, elle persiste (et empire) dans le contexte de lutte contre le terrorisme, de même qu’elle sévit dans des pays qu’on pensait préservés de ce genre de pratiques, comme les Etats-Unis. En quoi cela entrave-t-il votre travail ?
Les stratégies de défense de certaines grandes démocraties, pour lutter contre le terrorisme notamment, sont complètement contre-productives par rapport au travail que les organisations comme Avocats sans frontières essaient de faire dans des pays où - parce qu’ils sortent d’un conflit majeur - il est presque naturel de voir de tels agissements persister. On nous renvoie régulièrement les choses de la façon suivante : "Comment pouvez-vous nous dire à nous, policiers que vous formez, que ce type de comportement est interdit alors que le gouvernement américain a mis en place des mécanismes pour consacrer juridiquement le droit de recourir à la torture ?" Cela ne doit pas nous amener à baisser les bras ni à tenir un discours contraire à celui que le droit international affirme de manière très claire. Nous devons continuer à faire ce travail de sensibilisation, non seulement des populations mais aussi des autorités politiques, y compris dans des pays dont on pensait qu’ils n’iraient pas jusqu’à affirmer qu’on a le droit de torturer.
Quel argumentaire utilisez-vous à l’endroit d’une opinion publique ou d’hommes politiques qui justifient la torture si elle peut sauver des vies humaines ?
Rien aujourd’hui ne démontre que le recours à la torture ait empêché un quelconque acte criminel de se commettre. C’est un argument de rhétorique, à contester de manière factuelle.
Des informations recueillies avec violence à Guantánamo auraient permis d’arrêter Oussama Ben Laden…
Vous pouvez l’affirmer, mais rien ne permet de le prouver. C’est aussi un enjeu de civilisation qui se pose. Voulons-nous, les uns et les autres, vivre dans des sociétés où la fin justifie les moyens ? L’histoire a démontré que la violence institutionnalisée comme la torture, mise en œuvre pour de prétendus bons objectifs (préserver la sécurité, empêcher le développement de la criminalité), était utilisée à d’autres fins, contre des opposants politiques ou des activistes des droits humains. Nous, avocats sans frontières, voulons consacrer un droit aux victimes de torture d’être reconnues comme telles.
Quels sont les obstacles à l’établissement des faits et à la reconnaissance du statut de victime dans les pays où vous intervenez ?
Il s’agit d’Etats fragiles, où l’on rencontre des problèmes de volonté politique et de moyens financiers. Il y a d’abord des obstacles qui tiennent à la configuration de l’Etat. La République démocratique du Congo par exemple est un Etat qui fonctionne mal, avec de la corruption et une absence de volonté politique pour attaquer la question des violences commises par les agents de l’Etat, soldats ou policiers. Mais, comme au Népal, vous pouvez au moins y parler de la torture. Le Rwanda, en revanche, est un Etat très fort, très bien structuré, où il est quasiment impossible de parler de la torture et donc d’essayer de chercher des solutions.
Comment expliquez-vous que les victimes n’osent pas porter plainte dans le cas spécifique du Rwanda ?
Le Rwanda est un contexte évidemment très particulier, encore traumatisé par le génocide. De manière générale, il est très difficile pour les victimes de torture de s’exprimer. Regardez par exemple en Belgique ou en France : les victimes de violences sexuelles n’ont pas osé s’exprimer pendant très longtemps. Il a fallu des décennies de sensibilisation. Dans beaucoup de sociétés africaines, la victime de violences est très souvent stigmatisée par le groupe social, voire en est exclue. Il y a aussi une question de confiance. Il faut absolument que des acteurs sociaux - médecins, psychologues, responsables politiques ou acteurs de justice - puissent créer des conditions permettant aux victimes de torture de se déclarer comme telles, de déposer plainte et de casser cette logique d’impunité.
A quels autres obstacles devez-vous faire face ?
A la difficulté d’obtenir des données factuelles et précises. Le chiffre noir de la torture est massif mais inconnu. Toutes les victimes ne portent pas plainte, pour des raisons diverses : la peur d’un retour de bâton pire que ce qu’elles ont déjà subi ou le manque de confiance dans les acteurs de justice. On rencontre aussi des obstacles matériels, tels que la difficulté d’organiser des enquêtes, de récolter des preuves, d’auditionner les victimes dans des conditions de sécurité et de confort satisfaisantes, d’avoir des moyens d’investigation, de faire une autopsie. Par exemple, dans les Grands Lacs, il est extrêmement difficile de trouver un médecin qui acceptera à moindre coût, voire gratuitement, de faire un constat médical sur les victimes de torture. Il nous est arrivé de travailler avec des Médecins sans frontières. J’ai souvent vu des enfants des rues, petits voleurs de marché, arrêtés par la police de Bujumbura, embarqués au poste, et sur la peau desquels les policiers avaient fait couler du plastique On a affaire à des agents de l’Etat qui abusent de leur pouvoir en exerçant une violence innommable. La première chose à faire, c’est d’au moins trouver un médecin pour constater cette réalité. Sans quoi la justice ne peut rien faire. Il faut aussi s’assurer de la coopération des institutions judiciaires, qui doivent mettre suffisamment de moyens pour oser arrêter les tortionnaires et remonter la chaîne de commandement au niveau de ceux qui ont, soit donné des ordres de commettre des actes de torture, soit laissé faire. C’est une chose d’arrêter un soldat de base qui a commis un acte de violence, c’en est une autre de savoir s’il l’a fait sur instruction et de qui.
Quel type de réparation les victimes de torture peuvent-elles espérer ?
Les pays dans lesquels nous travaillons sont démunis et la réparation est symbolique, même lorsque nous obtenons, au terme d’un chemin de croix judiciaire, une condamnation du tortionnaire et de l’Etat. Dans tous les jugements que nous avons obtenus en RDC, l’Etat congolais est condamné, mais il n’a jamais versé un dollar à une victime.
L’arrêt en lui-même suffit-il à une victime pour se reconstruire ?
Non. La reconstruction passe par une prise en charge médicale et psychologique, par la conscientisation de l’environnement immédiat de la victime et par la justice. Etre reconnu comme victime de l’agent de police X du commissariat de telle ville est un élément fondamental, mais pas suffisant. Il faut rendre hommage à ceux qui acceptent d’utiliser la voie judiciaire, cela demande énormément de courage.
L’existence de la Cour pénale internationale a-t-elle changé votre travail ? Amène-t-elle les dirigeants à refréner l’utilisation d’instruments comme la torture ?
Incontestablement et, au-delà de la torture, pour le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre. La mise en place de juridictions internationales, ad hoc ou permanentes, a entraîné des changements de comportement. Les acteurs politiques légitimes ou rebelles ne peuvent pas faire comme si la CPI n’existait pas. Les juristes américains, qui ont encadré sous le gouvernement de George W. Bush le recours à la torture d’un point de vue juridique, n’avaient qu’un objectif : suffisamment verrouiller en droit le processus pour que les autorités politiques puissent être préservées d’éventuelles poursuites. Aujourd’hui, tous les dirigeants savent qu’ils sont potentiellement passibles de faire l’objet d’une enquête, de poursuites, d’une arrestation.
Que répondez-vous aux Africains qui se plaignent d’être la cible exclusive des mandats d’arrêt délivrés par la CPI ?
La plupart des situations ont été confiées à la CPI par les Etats africains eux-mêmes, qui ont manifesté une intention réelle de collaborer à l’œuvre de justice. Le continent africain devrait être fier d’avoir à ce point manifesté sa capacité à répondre aux victimes de crimes internationaux. Par ailleurs, ne résumons pas la justice internationale à la CPI. Tous les continents sont visés par des enquêtes et des poursuites. La communauté internationale a institué un tribunal ad hoc pour juger les crimes commis en ex-Yougoslavie par exemple et, au Cambodge, a lieu le procès des ex-dirigeants encore vivants qui auraient commis des crimes sous le régime des Khmers rouges.
(*) En particulier au Burundi, au Rwanda, en RDC, en Ouganda, au Népal, en Israël et en Palestine.
Sabine Verhest


/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F7%2F2%2F725160.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F95%2F04%2F837061%2F108455581_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F85%2F36%2F837061%2F97560182_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F40%2F85%2F837061%2F75707061_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F83%2F27%2F837061%2F75706865_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F55%2F837061%2F75571482_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F83%2F60%2F837061%2F134103380_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F82%2F13%2F837061%2F134051135_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F30%2F80%2F837061%2F133945706_o.jpg)